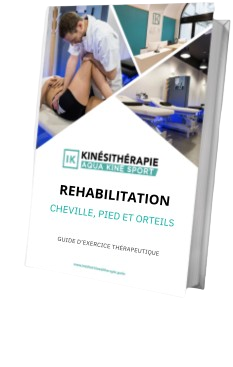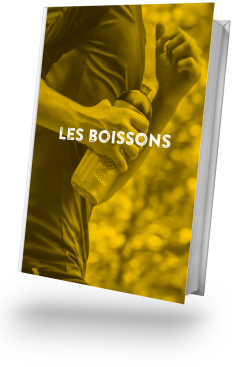La réathlétisation constitue une phase essentielle entre la rééducation et le retour à la pratique sportive, permettant aux athlètes de tous niveaux de retrouver leur place sur le terrain avec des performances maximales. Mais qu’est-ce que la réathlétisation exactement ? Qui peut bénéficier de cette approche ?

Suite à une blessure et à une période d’inactivité, de nombreux sportifs rencontrent des difficultés à retrouver leurs niveaux de performance d’origine. Cette interruption de l’entraînement entraîne un déconditionnement de l’organisme, qui se traduit par une perte des adaptations physiologiques apportées par l’exercice : on observe des changements au niveau cardiorespiratoire, métabolique, musculaire, articulaire et hormonal.
Face à ce constat, la réathlétisation a émergé comme une méthode spécialisée, située entre le domaine paramédical et l’expertise sportive. Elle est particulièrement recommandée après une blessure ou une période d’arrêt et est essentielle pour les athlètes de haut niveau. Cette approche vise à atténuer les effets résiduels de la blessure tout en remédiant au déconditionnement.
Il est important de ne pas confondre la réathlétisation avec la rééducation. Bien que cette dernière soit souvent une étape préalable ou concomitante, la réathlétisation se concentre sur la récupération des capacités fonctionnelles optimales, permettant ainsi au sportif de reprendre ses activités physiques. Son but est résolument sportif, même si elle a également des implications médicales.
Quelques chiffres et faits sur la réathlétisation
- En l’absence de réathlétisation, seulement 65 % des sportifs ayant subi une intervention chirurgicale pour le ligament croisé antérieur (LCA) parviennent à retrouver leur niveau de pratique antérieur (source 3).
- Cette observation met en évidence l’importance d’un accompagnement spécifique, complémentaire à la rééducation, qui prend en compte les besoins particuliers des athlètes.
- Suite à une rupture du LCA, la réathlétisation diminue de 66 % le risque de récidive chez les joueurs de football (source 3).
- Outre son impact sur les performances sportives, la réathlétisation revêt également une dimension médicale essentielle pour prévenir les blessures.
La réathlétisation est fréquemment perçue comme « une rééducation plus orientée vers le sport que sur le plan médical » (source 1). Son objectif principal est de permettre au sportif blessé de retrouver son niveau de performance optimal en adaptant son corps aux exigences spécifiques de sa discipline.
Cette approche est résolument multidisciplinaire, nécessitant une compréhension approfondie de la physiopathologie sportive, de la rééducation et des principes de l’entraînement. En conséquence, la réathlétisation est généralement réalisée par une équipe de professionnels ayant une expertise dans ces différents domaines : kinésithérapeutes spécialisés en sport, entraîneurs et préparateurs physiques.
Elle commence dès que possible après une blessure ou une opération, afin de réduire au maximum les effets du déconditionnement. La réathlétisation peut être initiée dès que le sportif est capable d’effectuer des exercices musculaires et cardiovasculaires sans compromettre le processus de cicatrisation.
Elle repose sur un certain nombre principes, notamment:
Contrairement à une idée reçue, la réathlétisation ne s’adresse pas uniquement aux sportifs professionnels. Bien que les athlètes de haut niveau soient les premiers à souhaiter retrouver d’excellentes performances, cette forme d’accompagnement concerne également :
Le kinésithérapeute du sport joue un rôle essentiel dans l’accompagnement des sportifs lors de leur réathlétisation. Il collabore de manière étroite avec le personnel technique, comprenant l’entraîneur et le préparateur physique.
Quand elle est mise en place après une blessure, la réathlétisation peut commencer :
L’évaluation clinique joue un rôle crucial lors des séances de réathlétisation, car elle permet d’adapter les exercices en fonction des capacités et de la tolérance du sportif. Réalisée à intervalles réguliers, cette évaluation comprend un interrogatoire et un examen clinique approfondi. Le kinésithérapeute effectue également des tests pour évaluer la récupération des capacités altérées, telles que la force musculaire, la sensibilité proprioceptive et les amplitudes articulaires.
Le processus de réathlétisation débute par une activation des segments sains du membre. Une fois l’inflammation réduite, le patient peut commencer des exercices légers, comme le pédalage, surtout si la blessure concerne un membre inférieur. Parallèlement, un programme de renforcement musculaire est introduit, utilisant des appareils tels que la presse et la chaise à quadriceps. Les séances incluent aussi des exercices pour travailler l’endurance cardiovasculaire.
Lorsque le sportif reçoit le feu vert pour courir, le travail athlétique peut débuter avec des exercices spécifiques à la course. Les capacités à développer et à mesurer incluent l’endurance, la capacité et la puissance aérobies, suivies de l’exploration des filières anaérobies. Des tests d’effort réguliers sont intégrés à cette phase de réathlétisation.
Pour terminer, la dernière étape se concentre sur les capacités spécifiques au sport pratiqué. Le kinésithérapeute propose alors des exercices adaptés aux gestes techniques et aux filières énergétiques demandées dans la discipline de chaque patient.