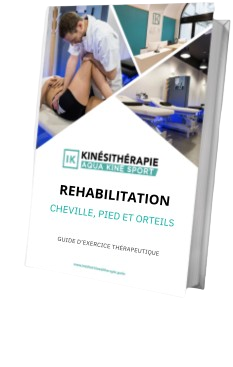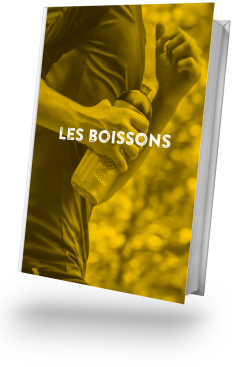La douleur est dite chronique lorsque le symptôme persiste depuis au moins 3 à 6 mois. Ces douleurs peuvent être causées par divers facteurs, et leur prise en charge nécessite une approche pluridisciplinaire.

Vous ressentez des douleurs chroniques dans une ou plusieurs parties de votre corps ? Ces douleurs peuvent provenir de différentes causes, souvent liées à une maladie ou un traumatisme. Parfois, il se peut que la source de votre douleur ne soit pas identifiée, mais cela n’enlève rien à sa réalité ni à l’importance de la prendre en charge. La douleur est qualifiée de chronique lorsqu’elle persiste depuis au moins 3 à 6 mois. Qu’il s’agisse de maux de dos, de cervicalgie chronique ou de fibromyalgie, les douleurs persistantes ont un impact significatif sur la qualité de vie : anxiété, isolement social, absentéisme au travail… autant de raisons qui incitent souvent à consulter.
Quelques chiffres et faits sur la douleur chronique en France
Loin d’être un fait isolé, la douleur chronique est un véritable enjeu de santé publique :
- 10 millions de Français sont touchés par ce problème, soit environ 1 adulte sur 5.
- 1 personne sur 2 souffrant de douleurs chroniques rapporte une altération de sa qualité de vie.
- 2 personnes sur 3 ne trouvent pas de soulagement avec leur traitement.
- La douleur chronique constitue le motif de 24 % des consultations en médecine générale.
-
Les causes potentielles de votre douleur sont multiples et parfois difficiles à déterminer. Le risque de développer une douleur chronique est plus élevé si vous êtes atteint de l’une des affections suivantes :
Lorsque la douleur provient d’une lésion nerveuse, on parle de douleur neuropathique. Dans certains cas, l’un des défis de la douleur chronique réside dans le fait qu’elle persiste, même lorsque sa cause initiale a disparu, rendant le symptôme particulièrement frustrant et difficile à gérer.
La douleur est un phénomène complexe qui n’est pas uniquement physique ; elle comporte également une dimension mentale et émotionnelle. En effet, les zones du cerveau impliquées dans le traitement des émotions (comme le cortex cérébral et le système limbique) participent également au traitement des signaux douloureux. De nombreuses recherches en neurosciences ont démontré le rôle des émotions dans la perception de la douleur : plus les émotions sont négatives, plus les seuils de douleur sont abaissés ; à l’inverse, des émotions positives peuvent atténuer la perception de la douleur.
Ainsi, la douleur chronique peut être favorisée ou amplifiée par des facteurs tels que :
Selon des paramètres tels que l’intensité, l’origine ou la localisation, les caractéristiques d’une douleur chronique peuvent varier. Elle peut être modérément inconfortable ou très invalidante, vive comme une “décharge” ou bien sourde et diffuse. Dans certains cas, certains mouvements et activités peuvent intensifier la douleur.
En général, l’effet principal des douleurs chroniques est leur impact sur la qualité de vie et l’état psychologique des personnes concernées. L’anxiété peut aggraver la douleur, mais l’inverse est tout aussi vrai : les douleurs ressenties quotidiennement alimentent les états dépressifs et/ou anxieux, créant un cercle vicieux bien connu des patients souffrant de douleurs chroniques. Les troubles du sommeil, en particulier l’insomnie, sont fréquents et contribuent à renforcer cet engrenage.
Lorsque les douleurs deviennent très gênantes, la vie sociale dans son ensemble en est affectée : selon plusieurs études et enquêtes, les personnes souffrant de douleurs chroniques disent se sentir isolées, rencontrer des difficultés à s’occuper de leurs enfants, et font face à l’absentéisme et à des difficultés dans leur vie professionnelle.
Les douleurs persistantes ne sont pas une fatalité ; si vous êtes concerné, des professionnels de santé, dont votre kinésithérapeute, peuvent vous aider. La prise en charge de la douleur chronique est souvent multidisciplinaire, et la kinésithérapie intervient en complément d’autres approches pour vous accompagner dans la gestion et le soulagement de vos symptômes.
Le déroulement des séances dépendra bien sûr de la localisation et de l’origine de vos douleurs. Les douleurs chroniques du dos et la fibromyalgie sont des raisons fréquentes de consultation.
La prise en charge débute toujours par un bilan, où le kinésithérapeute évalue votre douleur au moyen d’un questionnaire et d’un examen. Ce recueil d’informations est essentiel pour établir un programme de soins adapté à vos besoins.
L’exercice physique est souvent recommandé dans le traitement des douleurs chroniques, apportant des bienfaits tant physiques que psychologiques : il aide à surmonter la peur de bouger et à retrouver progressivement la confiance en soi. Au cours des séances, vous pratiquerez des exercices pour vous réhabituer peu à peu au mouvement. Certaines séances peuvent également être réalisées en groupe, permettant à chacun de bénéficier de la dynamique collective.
En complément de ce reconditionnement physique, qui améliore la qualité de vie à moyen et long terme, des techniques comme les massages ou la physiothérapie peuvent être utilisées pour un soulagement plus immédiat de la douleur.
Si vous souffrez de douleur chronique, votre médecin peut vous prescrire des médicaments pour la soulager au quotidien ; bien qu’ils ne traitent pas directement la cause sous-jacente, ils contribuent à améliorer votre bien-être. La plupart du temps, des antalgiques comme le paracétamol ou l’ibuprofène vous seront proposés.
Pour les douleurs particulièrement persistantes, des opioïdes peuvent être prescrits ; cependant, le risque de dépendance et les nombreux effets secondaires imposent de les utiliser avec précaution.
Une part essentielle du traitement de la douleur chronique repose sur le soutien et l’accompagnement psychologique. Ce rôle est en partie assuré par tous les professionnels de santé impliqués, comme votre médecin traitant et votre kinésithérapeute. Vous pouvez également consulter un psychothérapeute, en particulier si celui-ci pratique la thérapie comportementale et cognitive (TCC), qui peut s’avérer très bénéfique.
Le diagnostic de douleur chronique est établi lorsque la douleur persiste depuis au moins 3 mois. L’interrogatoire constitue une étape essentielle de ce diagnostic : votre médecin cherche à comprendre l’histoire de votre douleur, les circonstances de son apparition, ainsi que vos antécédents. Il identifiera également des facteurs susceptibles d’aggraver la douleur, tels que le stress lié au travail ou à la famille.
La quantification de la douleur est un autre élément clé ; pour cela, les professionnels de santé utilisent des échelles de douleur, qui peuvent être visuelles, verbales ou sous forme de questionnaires.
Enfin, le diagnostic comprend toujours un examen clinique, parfois accompagné d’examens d’imagerie, qui peuvent contribuer à déterminer la cause de la douleur.